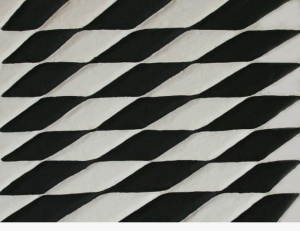Nous avons fait silence.
Nous regardons les bulles éclater à la surface. Il y a quelques grosses bulles et puis des milliers de toutes petites bulles qui forment une mousse blanche et qui crépitent en atteignant la surface. Nous regardons la mousse des toutes petites bulles qui grésille et les quelques grosses bulles qui restent entières une seconde ou deux avant d’éclater. Nous nous taisons. Nous écoutons nos bulles éclater une à une. Nous pouvons imaginer leur trajet depuis le fond jusqu’à la surface. Nous avons conscience de l’itinéraire tortueux de chacune de ces bulles, nous savons qu’il a fallu explorer des archives, remuer des récits, brasser des souvenirs pour les déloger. Nous avons dû aller les chercher. Nous savons que le spectacle de ces bulles qui éclatent est précieux, que c’est vers ce spectacle que nous tendons depuis le début de l’atelier. Nous nous taisons pour entendre chaque texte, pour écouter comment chacun a réussi à rendre accessible des choses enfouies en ré-inventant une histoire entendue, en ré-écrivant un souvenir, en décalant une image ou en y apposant un filtre différent.
Nos textes sont des bulles qui éclatent à la surface de nos voix lorsque nous lisons.
*
Nous retenons notre souffle.
Les lapins sautillent. Leur poil est très blanc, presque trop blanc. Leurs oreilles sont immenses. Ils les remuent doucement dans la lumière des projecteurs, au milieu des paillettes. Ils sont presque irréels ces lapins. Nous retenons notre souffle parce que nous y croyons, parce que nous sommes éberlués, parce que nous sommes ravis de voir des lapins blancs apparaître en nuée bondissante. Nous regardons les lapins cabrioler en bougeant leurs moustaches, en faisant frétiller leurs petites queues, en remuant leurs museaux légèrement roses. C’est le même rose que l’on peut apercevoir furtivement sous leurs pattes lorsqu’ils sautent très haut. Nous fixons les lapins blancs qui émergent du noir d’un chapeau haut de forme, les lapins blancs qui ont l’air de tomber d’une baguette blanche au bout d’une main gantée de rouge. Nous sommes émerveillés, jusque-là nous ne savions pas si le tour allait marcher, si les lapins bondiraient ou si le chapeau noir resterait vide. Nous aimerions applaudir mais nous retenons notre souffle, nous attendons que tous les lapins soient sortis du chapeau noir. Alors, et alors seulement, lorsqu’ils seront tous là, très blancs, remuant les oreilles, sautant ça et là, lorsque tous nos lapins blancs avec le dessous des pattes roses seront là, alors, nous applaudirons.
Nos textes sont des lapins blancs que nous avons réussi à faire jaillir de nos chapeaux.
*
Nous écarquillons les yeux.
Les fleurs qui grossissent et s’ouvrent peu à peu sont d’un rouge vif avec de petites touches de orange et de bordeaux. On dirait qu’elles ont été peintes avec un pinceau très délicat, très fin. Les fleurs surgissent en épis le long de la tige très verte. Elles se déplient sous nos yeux. Nous passons notre journée à les regarder changer de forme. Des oiseaux minuscules viennent picorer le cœur des fleurs rouges. Ils s’en délectent. Les fleurs ont mis quelques jours à prendre forme, nous les avons vues apparaître en boutons verts à bout rouge puis grossir jusqu’à atteindre la taille d’une petite banane. Elles se sont déployées enfin et elles ont pris la même forme que les oiseaux qui viennent s’y poser. Elles ont un bec long et fin, au bout d’un corps dodu. Nous écarquillons les yeux parce que l’illusion est saisissante. Nous nous demandons si ce sont les fleurs qui ressemblent aux oiseaux ou si ce sont les oiseaux qui imitent les fleurs. Nous ne cherchons pas vraiment à avoir la réponse à cette question, nous nous laissons captiver par les couleurs qui se répondent.
Nos textes sont des fleurs qui ont pris leur temps pour atteindre la forme délicate d’oiseaux de paradis.
Louise Mutabazi